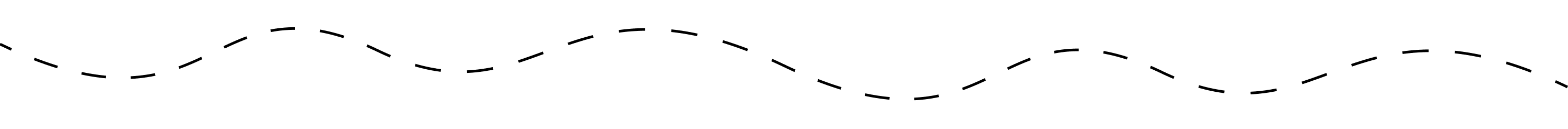La petite sirène

Texte : Hans Christian Andersen
Traduction : Jean-Baptiste Coursaud
Illustration : Benjamin lacombe
Éditeur : Albin Michel jeunesse
144 pages
Prix : 24,90 €
Parution : 23 novembre 2022
ISBN 9782207136386
Ce qu’en dit l’éditeur
Dans les profondeurs marines vivent le roi de la Mer et ses six filles sirènes. Le jour de ses quinze ans, la benjamine est autorisée, comme le veut la tradition, à monter à la surface de l’eau pour observer de plus près le monde des humains. Fascinée, elle tombe immédiatement amoureuse d’un prince. Pour le séduire, elle accepte de renoncer à sa queue de sirène et de perdre l’usage de sa voix…
Cette édition exceptionnelle propose une nouvelle lecture du conte le plus connu d’Andersen et présente des lettres issues de sa correspondance, dont certaines jamais traduites en français. Benjamin Lacombe pose sur La Petite Sirène un regard personnel d’une modernité et d’une sensibilité bouleversantes.
Benjamin Lacombe a réinterprété de nombreux contes classiques tant européens que japonais depuis le début de sa carrière. Il est même devenu directeur d’une collection de contes illustrés chez Albin Michel. Pour lui, ces récits sont en effet un matière vivante et pas du tout des textes désuets ou poussiéreux car ils « ont en leur sein le reflet de l’âme humaine, des problématiques profondes qui les font transcender toutes les époques et toutes les cultures ».
Après « Ondine » (1811) de Friedrich de la Motte Fouqué paru en 2012, il s’attaque au conte qui s’en est inspiré : La petite Sirène d’Andersen (1837) toujours chez Albin Michel.

On a tous en mémoire l’histoire : celle de la benjamine des six filles du Roi de la mer qui, comme le veut la tradition, est autorisée le jour de ses quinze ans à monter des abysses où se trouve son royaume pour venir observer les humains et regarder passer les bateaux. Le jour dit, elle remarque un trois mâts où l’on donne une fête. C’est un jeune prince qui y est célébré. Dès qu’elle le voit, la sirène tombe éperdument amoureuse de lui et sera prête à tous les sacrifices pour le conquérir …


C’est un récit qui tient à cœur au dessinateur qui avait déjà le projet de l’adapter lors de sa première rencontre avec son éditrice chez Albin Michel. Sans doute parce qu’il a grandi avec le film que l’équipe Disney avait tiré de l’œuvre danoise (auquel il rend hommage dans une illustration récente) mais surtout parce qu’il en pressentait la profondeur cachée.
UNE AUTOBIOGRAPHIE SECRÈTE

Lacombe aime bien étayer ses récits de documents historiques : ainsi, il avait émaillé son album « Marie-Antoinette : carnet secret d’une reine » (coécrit avec l’historienne Cécile Berly) d’extraits de la correspondance de la reine et celui sur « Frida Kahlo » (avec Sébastien Perez au scénario) de fragments du journal de l’artiste. Pour sa mise en image du conte, il a donc effectué de nouveau des recherches et il est tombé sur des thèses d’Harvard dans lesquelles il est fait mention de lettres qu’Andersen aurait écrites au fils de son bienfaiteur, Edvard Collin, mais il n’en trouva nulle trace et finit par douter de leur réelle existence.
Il voulait repartir du texte initial car, au fur et à mesure du temps et des traductions policées, le sens premier des contes s’estompe. Il a donc fait appel à Jean-Baptiste Coursaud, traducteur spécialiste de littérature pour la jeunesse et de littérature des pays scandinaves. Ce spécialiste a directement retraduit le conte à partir du manuscrit d’Andersen et il a fait deux découvertes qu’il explique dans sa postface. D’abord une fin biffée par Andersen, nous y reviendrons, et surtout les fameuses lettres publiées par Edvard Collin lui-même dans ses « Mémoires » dès 1882, qui attestent de l’amour qu’éprouvait le conteur à son égard. Des extraits de cette correspondance sont publiés pour la première fois en français dans les dernières pages de l’album et on y perçoit bien à la fois la ferveur d’Andersen et le rejet de Collin. Le 10 août 1836, Edvard épouse Henriette Thyberg. Andersen n’a pas été invité au mariage. Il éprouve une grande souffrance et il entame, ce jour-là, précisément, l’écriture de « La petite Sirène ».

Forts de ces nouvelles clés de lecture, Benjamin Lacombe et Jean-Baptiste Coursaud postulent ainsi que l‘auteur danois met dans son conte tout son sentiment d’impossible et son désespoir amoureux et que son œuvre des mue en un récit à clés. Derrière la figure du prince se cache Edvard Collin, Henriette Thyberg est la princesse que celui-ci épouse et Andersen s’est portraituré en petite sirène. C’est pourquoi l’illustrateur prend le parti pris d’une petite sirène androgyne aux cheveux au carré (et non à la longue chevelure comme précisé dans le conte et dans l’iconographie traditionnelle) qui a les traits du conteur.
« J’ai voulu ramener le créateur sur sa créature, sa coiffure et son regard rappellent ceux d’Andersen. Dans une certaine mesure évidemment, car le texte insiste sans cesse sur sa beauté, et le visage de son créateur était malheureusement plutôt disgracieux ».

THE DANISH GIRL
Dans « Ondine », Lacombe rendait hommage aux Préraphaélites anglais, Waterhouse et Millais. Ici on peut trouver des références aux architectures paysages d’Eva Jospin (que l’on découvre dès la première double page) et à de grands illustrateurs comme Edmond Dulac mais l’on pourra également y percevoir un renvoi à une peintre des années folles Gerda Wegener et surtout à son modèle favori : son mari Einar dit Lili qui fut la première femme transgenre (danoise de surcroit) dont l’histoire donna lieu à un roman de David Ebersoff en 2000 puis à un film « The Danish girl » de Tom Hooper quinze ans plus tard.


Les traits délicats de La petite sirène et ses grands yeux rappellent en effet ceux de Lili Elbe et de l’acteur qui l’incarna, Eddie Redmayne. Le fond rejoint le thème et la citation artistique délivre le message caché.

Pour Benjamin Lacombe, il s’agit en effet d’une « histoire d’amour empêché, de corps contraint, de transformation et d’ambiguïté des genres » car, pour pouvoir être aimée du prince, la petite sirène doit se mutiler la queue, perdre sa voix afin de devenir une femme humaine. Et elle accepte, malgré toutes les mises en garde qui lui sont faites, les obstacles à franchir et les souffrances qu’elle devra endurer. Le conte serait ainsi une métaphore de la transidentité et du vœu secret de son créateur : devenir une femme, ou une « fille de l’air » pour être aimé pour ce qu’il se sent être réellement. On renverra alors le lecteur à la fin biffée signifiante, ou à la couverture où les coraux entrelacés créent l’image d’un sexe féminin formant un médaillon qui encadre la sirène Andersen.

LA SYMBOLIQUE DES COULEURS
Dans le conte, on trouve de nombreuses mentions du bleu des abysses et fond marin et du rose ou rouge poudré des fleurs du jardin de l’héroïne ou des reflets du soleil couchant sur le château du Prince. Bleu et rose deviennent la palette principale à la fois fidèle et symbolique de Benjamin Lacombe. Il a travaillé à la gouache avec des couleurs très tranchées et genrées : un bleu profond associé au genre masculin et un rose artificiel, fluo, éclatant, pour créer graphiquement le trouble et l’idée d’une société à deux polarités. Le personnage de la petite sirène détient en son sein les deux couleurs qui évoluent en fonction de ses sentiments. Et le violet de sa queue de poisson, couleur de la transidentité entre le rose et le bleu, évoque sa fluidité de genre.

Ce conte à la sauce Lacombe pose aujourd’hui un regard nouveau sur les questions essentielles de la transformation et de la transidentité. Dans le recueil original de 1837, et c’est la seule fois qu’il le fera, Andersen met un avertissement au lecteur et insiste sur le fait que « La Petite Sirène » est un conte « très différent » de ses œuvres précédentes « dont seul le [lecteur] plus âgé comprendra la signification profonde ». La double préface de Coursaud et Lacombe ainsi que l’éclairante postface du traducteur s’adressent également aux adultes de façon documentée et passionnante et révèlent la genèse de l’œuvre et les différentes strates qui la constituent. C’est un fort bel objet artistiquement, littérairement et humainement parlant. La relecture proposée pourra peut être gêner quelques fâcheux (tout comme le fait que dans la production Live action de Disney Ariel soit interprétée par l’actrice noire Halle Bailey) mais elle met surtout en exergue la richesse, la vitalité, la profondeur du conte. Quant au jeune public, il devrait également apprécier au premier degré cette belle recréation qui émerveille et émeut éternellement.

POUR ALLER PLUS LOIN
2 albums de Benjamin Lacombe
Ondine
Benjamin Lacombe
2012
le conte qui inspira Andersen


Marie Antoinette : carnet secret d’une reine
Benjamin Lacombe et Cécile Berly
mêle à la fois fictions et correspondance réelle (avec Marie-Thérèse d’Autriche et Axel Fersen entre autres)
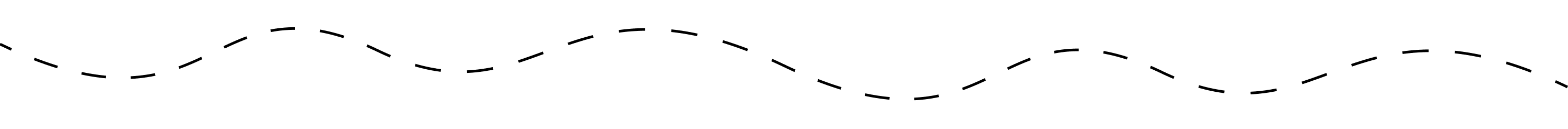
Le roman et le film qui racontent le parcours d’Einar Wegener pour devenir Lili Elbe


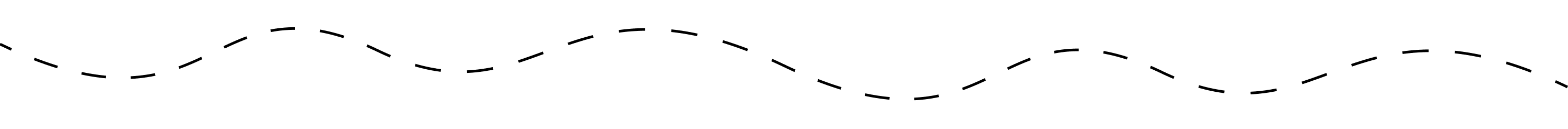
Interview de Benjamin Lacombe par Anne-Marie Revol sur France Info à propos de son adaptation de La petite Sirène
https://www.facebook.com/BenjaminLacombeofficial/videos/814456816521170/
Chronique d’Anne-Laure GHENO
(Bd Otaku)